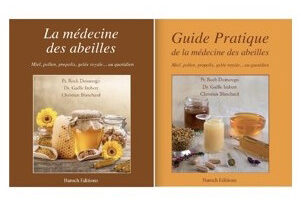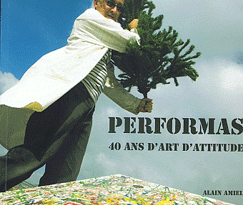Jacques Dupin, Par quelque biais vers quelque bord
L’espace autrement dit publié aux éditions Galilée en 1981 était épuisé. Les textes de Jacques Dupin sur Miro, Giacometti, Tapiès sortaient à part. restait à reprendre les autres textes, à leur adjoindre ceux parus entre temps, à conserver le beau texte de Jean-Michel Reynard – Placé en fin de volume, il partage avec la foudre son tracé de nuit. Touchant terre, ici ou là, en tel ou tel texte, sur tel ou tel peintre, ses propos remontent en lumière – confier à Emmanuel Laugier, à qui l’on doit Strates, ensemble d’études sur l’œuvre de jacques Dupin, paru chez Farrago en 2000, le soin d’ouvrir ce volume par une préface, don d’air, prise de souffle avant de se lancer dans la lecture de ces 47 textes, le plus souvent de commande, écrits entre les années 1953 (texte sur Max Ernst, paru aux Cahiers d’Art) et 2006 ( texte sur Jean Capdeville, paru dans le catalogue Un peintre et des poètes, Centre Joë Bousquet et son temps, Carcassonne)
Ah ! Les indéfinis du titre Par quelque biais vers quelque bord ! C’est que nous voilà perdu en pays de peinture : 5 chapitres, 47 textes, 35 artistes dont 5 sculpteurs . De Kandinsky à Capdeville en passant par Braque, Sima, Pollock, Kolar, De Staël, Michaux, Adami, Saura, Bacon, Riopelle, Rebeyrolle, Alechinsky…on ne saurait tous les citer. Perdus comme il convient quand c’est dans l’inconnu qu’on avance.
C’est entendu Jacques Dupin n’est ni historien, ni critique. Jacques Dupin est poète. Il est le poète de l’écart, quelqu’un qui partage avec les artiste cet « œil de rapace » fixé sur cet « au-delà de la peinture qui pourrait bien n’être que l’avenir de la peinture » comme il le dit dans ce texte inaugural sur Max Ernst en 1953. Voilà que nous ne reconnaissons plus rien de ce que l’on connaissait ou plutôt croyait connaître. Alors il nous faut bien avancer, pousser quelques pas et pour cela emprunter « quelque biais » moins pour arriver quelque part que pour se diriger vers ce qui pourrait faire bordure. Du coup, lire ces textes comme des marins tirent des bords quand la mer est toute au vent et que s’est imposé le tourmentin. Quand « chaque pas naît de la nuit », que « chaque geste naît du chaos » se trouve alors instauré un ordre, celui de la forme qui déploie l’espace. Ordre « aussitôt contesté et ruiné au hasard, à l’attente du prochain élan ». Ainsi les œuvres restent-elles ouvertes, toujours en route vers elles-mêmes, hors conclusion, du côté de l’oiseau de Braque, « oiseau terrestre » qui incarne « l’impossibilité de conclure (…) le perpétuel contre l’éternel » rappelle Jacques Dupin, le perpétuel et son bruit de source.
« Un air vif souffle sur la forme ouverte et les couleurs soulevées », il passe sur ce livre en de brusques à coups, c’est dire si l’on respire dans ces pages où tout se renonce, se reprend sans fin comme dans ces œuvres d’Henri Michaux où les signes « (captent) l’énergie par (leur) indétermination même. La (captent) et la (relancent) aussitôt à d’autres signes et à leur unanime agitation. Toutes les communications sont ouvertes par ce pouvoir de liaison et de rupture du signe avec le plus prochain et le plus lointain. Et dans cet incessant rebond… » Voilà, on y est !
Nous voilà au plus près de ce que Jacques Dupin nomme un « nerf actif et plus éveillé que tout être vivant », « énergie universelle, qui de la partie au tout, de proche en proche, fait poindre et surgir l’espace », force qui travaille les œuvres, ces territoires du corps à corps. « Surcroît d’énergie » libéré par « un affrontement où la violence, l’érotique, la lucidité, le jeu et le défi de peindre se (relayent) et (fusionnent) pour transgresser le constat et faire surgir la vie et son inconnu de la destruction des apparences ». Cette force qui « soulève et irrigue l’espace pictural » est le produit « d’ un acte plus que d’une pratique » écrit Jacques Dupin à propos d’Antonio Saura. Un acte où il s’agit d’ « être / le premier venu » – Je ne saurais oublier que ce sont là les deux vers d’un poème de René Char intitulé « Amour » !
À lire ces textes on sent bien que les artistes ici accompagnés travaillent non avec ce qu’ils ont, ce dont ils disposent, mais avec ce qu’ils n’ont pas. On comprend qu’ils puisent leur force dans le vide qu’ils ouvrent et auquel ils osent confier leur désir d’arracher à l’inconnu quelque chose qu’ils ne connaissent pas encore. Leur force est de se mettre en danger, de se démunir de tout et de se lancer dans la pente si le terrain est à la descente ou d’attaquer la paroi si les pieds ont besoin des mains pour se hisser ! C’est alors que s’ouvre, pour eux, l’espace, à partir d’un trait, d’une couleur, d’une forme risquée. Marche en avant qui toujours désaccorde le paysage, nerfs et rage le ravageant comme le grand vent tient ensemble sans les unifier les éléments contraires sous grand soleil décapant.
Chacun des textes ici repris est une coulée de lave, de celles qui vont lentes au long des pentes portant la musique tue des explosions ou qui, parfois, sautent, brusques, comme font les eaux au dévalé d’un torrent. Ces textes de Jacques Dupin sont tous écrits « avec le souffle qui (les) traverse, comme il l’écrit dans Echancré – paru chez P.O.L, livre aujourd’hui repris avec Contumace et Grésil dans Ballast dans la collection Poésie/Gallimard – l’inutile et le nécessaire « qui vient d’ailleurs, et qui va plus loin ». Quelque chose de « fatal ». « Fatal », premier mot du premier texte – il est consacré à Malevitch – et que l’on retrouve dans un texte sur Braque. Fatal, ce qui « (rompt) l’amarre entre le peintre et son tableau et le jette sur les routes. Fatal comme source inépuisable d’action et seule manière de se découvrir soi-même tendu vers l’autre, vers l’insaisissable autre. Fatal que ressent Jacques Dupin au contact des œuvres. Fatal comme « violence et jouissance confondues (…), écrit-il, la vérité de toute la peinture, l’immédiateté de sa rencontre et l’approfondissement de la commotion ».
Sur la scène de la création, ces textes de Jacques Dupin sont répliques aux pointes des artistes. Tous disent, oui, vos œuvres sont vivantes. Et je vis d’elles ! Là où personne ne s’attend à me trouver. Dans ma forêt. Entre hure de sanglier, sabot de cerf et violettes des fourrés ! Et nous vivons de ces textes !
par Alain Freixe
Jacques Dupin
Par quelque biais vers quelque bord
P.O.L, mai 2009